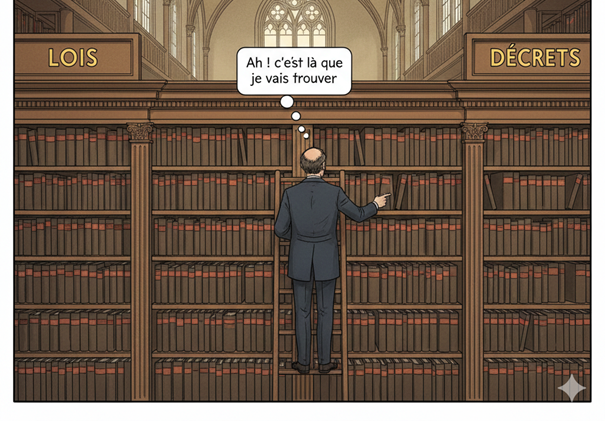On dit parfois qu’il y a autant de sélectionneurs potentiels pour l’équipe de France de football que de Français. A écouter les commentaires qui pleuvent depuis la parution du rapport de la Cour des Comptes sur France Télévisions ce mardi 23 septembre, le nombre doit être proche s’agissant des experts de l’audiovisuel public. En y ajoutant, rançon de l’époque, le petit refrain complotiste vaillamment entonné par le trio Sébastien Chenu, Pascal Praud, Paul Amar, selon lequel Pierre Moscovici aurait caché le rapport sous son bureau depuis le printemps, pour ne pas mettre en danger la reconduction à son poste de Delphine Ernotte.
Certains préfèrent l’air du train de vie avec, pour l’illustrer, le « scandale des taxis ». Comme l’indique le rapport, il est vrai que le poste a explosé de presque 32 % en 2024, pour se situer à 3,8 M€, soit… 1,5 pour mille du budget du groupe. Et avec un écart entre 2023 et 2024, 0,9 M€, qui a peut-être à voir avec les évènements particuliers de l’année (élections, Jeux Olympiques…).
Dans Le Figaro, un « éminent acteur », malheureusement anonyme, pointe que « pour atteindre un point d’audience, France Télévisions dépense un peu plus de 100 millions d’euros, TF1 autour de 65 millions d’euros. Et M6, entre 60 et 70 millions d’euros ». La réflexion vaut de s’y attarder, mais pas pour se limiter à affirmer, comme l’interlocuteur du quotidien : « Mettez un Nicolas de Tavernost à la tête de France Télévisions et donnez-lui cinq ans ! Il fera la même part d’audience avec 1 milliard d’euros en moins ».
Mais alors pour quelle télévision ? Pour émettre un diagnostic sérieux, il faudrait évidemment pouvoir distinguer, dans le budget de France Télévisions, ce qui relève du fonctionnement normal d’une entreprise et ce qui est lié à ses missions de service public.
Définir le chemin qui conjuguera au mieux efficacité économique et intérêt général suppose de revenir aux fondamentaux : établir les missions, sans céder à la tentation d’ajouter la liste à chaque fois que l’occasion s’en présente comme la loi de 1986 en porte aujourd’hui les stigmates, mais en se concentrant sur les priorités.
Décider, par exemple, si l’audiovisuel public est prioritairement destiné à informer, cultiver et distraire, selon le fameux triptyque, ou s’il est également un outil de soutien économique aux filières de l’audiovisuel et du cinéma, justifiant de niveaux de contribution financières sensiblement supérieurs à ceux des chaînes privées.
Déterminer encore si l’audiovisuel public doit s’adresser au même public que ces dernières, ou être attentif à ceux qui sont commercialement moins recherchés, les plus âgés notamment.
On pourrait allonger à l’envie la liste des questions à éclaircir.
Mais alors que l’audiovisuel vit au rythme de la révolution numérique, il n’y a pas eu de débat législatif digne de ce nom autour de l’audiovisuel public depuis la réforme Sarkozy de 2008, à l’Assemblée nationale au moins. A défaut de grand rendez-vous avec la représentation nationale, on pourrait souhaiter au moins que l’exécutif manifeste un peu de constance dans le cap financier qu’il donne à l’audiovisuel public.
La Cour des comptes recommande d’ailleurs « l’adoption d’un contrat d’objectifs et de moyens adossé à une trajectoire financière pluriannuelle stabilisée pour toute la durée du contrat, afin de donner un cadre clair à la direction de l’entreprise ». Sur le papier, de tels contrats existent depuis plus de deux décennies. Jusqu’en 2020, ils ont été régulièrement préparés, longuement négociés, signés… et jamais exécutés jusqu’à leur terme. La période actuelle est encore allée un cran plus loin, puisque les contrats qui devaient s’appliquer à partir de 2024 n’ont même jamais été signés.
Dans la situation politique qui vaut aujourd’hui, il apparait probable que la proposition de loi Lafon proposant d’organiser le regroupement de l’audiovisuel public en restera là de son parcours législatif, et on peut douter que le projet de loi chargée d’inscrire dans la loi les conclusions des Etats Généraux de l’Information fasse même l’objet d’un dépôt en Conseil des ministres.
La campagne des prochaines élections présidentielles permettra-t-elle de débattre au fond de l’audiovisuel public, mais des médias plus généralement ? L’expérience pousse à être sceptique puisque la place de ces sujets est traditionnellement des plus limitées. La toile de fond digitale, avec ce qu’elle porte d’enjeux touchant à l’information (ou sa manipulation), à la souveraineté culturelle et finalement aux jeux de dominos politiques et économiques permettra-t-elle de changer la donne ?
Nous ne sommes plus qu’à 18 mois des élections.