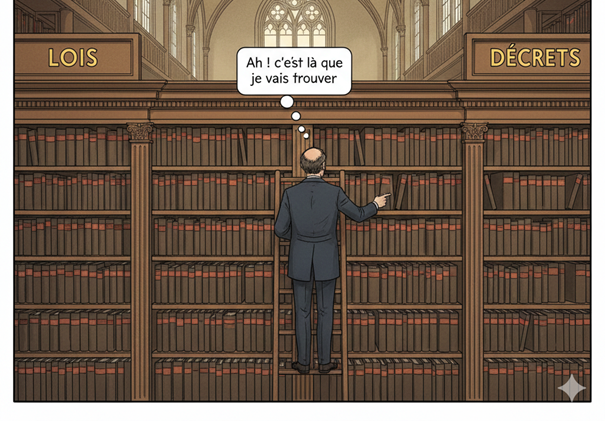« Le lien est clair entre la consommation d’information locale et la vitalité démocratique : plus un territoire dispose de médias actifs, plus la participation électorale, la confiance et l’engagement citoyen sont élevés, affirmait en début de semaine, l’étude réalisée conjointement par la Fondation Jean Jaurès et par l’association Les Relocalisateurs. À l’inverse, certaines zones en voie de « désertification médiatique » voient progresser la dépendance aux réseaux sociaux et reculer les comportements civiques ». Avant de l’être pour la France, cette relation a été largement documentée outre-Atlantique, ainsi que le pointait lors des Etats Généraux de l’Information le rapport du groupe 3 : « Aux États-Unis, la moitié des comtés n’a plus d’organe de presse locale et 70 millions de personnes vivent dans un désert informationnel, ce qui se traduit directement dans la participation aux élections et la partition de la vie politique : c’est une crise de et pour la démocratie[1] ».
Ce cercle vicieux est d’autant plus marquant que les médias américains se sont historiquement structurés autour des marchés locaux, qu’il s’agisse de la presse écrite, de la radio ou de la télévision, et de niveaux records de chiffre d’affaires publicitaire grâce à un marché presque totalement dérégulé (s’agissant par exemple de publicité politique ou du secteur de la distribution).
La progression des déserts informationnels pourrait être d’autant plus rapide, en France, que les marchés locaux sont loin d’y avoir connu le même développement, et que l’offre d’information de proximité est restée fortement polarisée sur le bloc PQR/PQD/PHR et sur l’audiovisuel public (France 3 et France Bleu). La promesse des radios privées locales ou régionales est restée centrée sur la musique. Et les télévisions locales privées ne sont pas parvenues à prendre une place structurante.
Comme souvent, malheureusement, dans l’histoire audiovisuelle français, la myopie des autorités publiques (CSA, exécutif et Parlement) y a beaucoup contribué.
Que les médias locaux aient subi de la même façon que les supports nationaux certaines décisions, la surprolifération des mentions légales dans le cas de la radio par exemple. Ou qu’ils aient fait l’objet de traitements spécifiques et, notamment, dans le cas de la télévision, la « politique d’éparpillement » qui a étouffé le développement de la télévision locale (impossibilité pour les titres de la PQR qui s’y investissaient de faire valoir la moindre synergie avec leurs rédactions… jusqu’à longtemps exiger que la chaîne dispose de locaux distincts, ou conditions empêchant – de fait – la constitution de networks à l’américaine dans lesquels les émissions locales auraient été complétées par des programmes nationaux en syndication suffisamment attractifs).
A la myopie des responsables publics s’est ajouté l’esprit gaulois, qui préfère trop souvent le coup de patte au voisin plutôt que le front commun opposé à une menace partagée.
Les conditions dans lesquelles le décret d’août 2020 a ouvert les écrans de TV à la publicité adressable en sont une bonne illustration. A l’heure où la demande de ciblage se renforçait de la part des marques, maximiser l’efficacité de la TVS aurait pu conduire à laisser les spots diffusés en décrochage intégrer l’adresse de la marque ou de ses points de vente, d’une part, à monter des offres communes entre régies de télévisions et autres acteurs de la publicité locale, afin de faire valoir auprès de leur clientèle de PME la grande accessibilité financière de la TVS, de l’autre ? Mentionner une adresse est interdit par le décret, et aucune collaboration ne s’est mise en place sur la commercialisation des inventaires…
Pendant que les médias français faisaient monétisation à part sur les marchés locaux, le search, support par excellence des annonceurs de proximité de la longue traine a vu son chiffre d’affaires progresser de presque 80 % entre 2020 (2,546 Mds€) et 2024 (4,482 Mds€) …
Au final, le cas de la TVS et le décret de 2020 illustrent les limites des politiques malthusiennes qui ont prévalu : brider le développement de cette nouvelle offre – le chiffre d’affaires net de la TVS n’a pas dépassé les 30 M€ –, sans ralentir l’érosion des recettes de la presse – faute notamment d’avoir monté des offres communes –, ni freiner, à l’inverse, la montée du digital – au search cité plus haut on pourrait ajouter naturellement les réseaux sociaux.
Alors que faire ?
Dans le cadre des Etats Généraux de l’Information, le groupe 3 s’était fixé une discipline visant à ce que ses propositions soient budgétairement neutres, et évitent la tentation de l’appel à la dépense. La recommandation visant à créer « un fond spécifique d’aide à la presse d’information générale et politique couvrant des zones géographiques ou le financement d’une information de qualité devient très difficile », afin d’éviter le développement des déserts informationnels, est la seule de ses 24 propositions à déroger à cette règle. Signe de l’importance majeure de ce sujet.
Mais parce qu’on ne peut imaginer que des financements publics tiennent durablement à bout de bras des médias locaux dont les ressources continueraient à s’étioler, la question est bien aux moyens de relancer les marchés publicitaires locaux.
Des plus techniques (autour du fonctionnement des blocklists) à la plus globale (sur l’instauration de la Responsabilité démocratique des annonceurs), plusieurs propositions de ce groupe 3 visent à soutenir les recettes publicitaires des médias qui financent l’information et la création, en profitant de la même façon aux médias locaux et aux supports nationaux.
En procédant de manière progressive et, dans un premier temps, au travers d’expérimentations, éditeurs de presse, acteurs de la radio et télévisions pourraient tenter de réussir, s’agissant de la publicité pour le secteur de la distribution, les collaborations qui n’ont pas été mises en place autour de la TVS.
Proposer un mouvement – quel qu’il soit – sur ce sujet des « secteurs interdits » expose à un tir de barrage. Si j’en prends le risque, c’est parce que les risques de l’immobilisme me paraissent plus grands encore. Pour le marché dans son ensemble, mais aussi pour chacun de ses acteurs. Et pour l’économie des éditeurs comme dans la capacité de chacune et chacun à continuer à bénéficier demain d’une information de qualité. De proximité tout particulièrement.

[1] Voir l’étude de l’Université de Northwestern: “More than half of U.S. counties have no access or very limited access to local news”.
[1] Voir l’étude de l’Université de Northwestern: “More than half of U.S. counties have no access or very limited access to local news”.