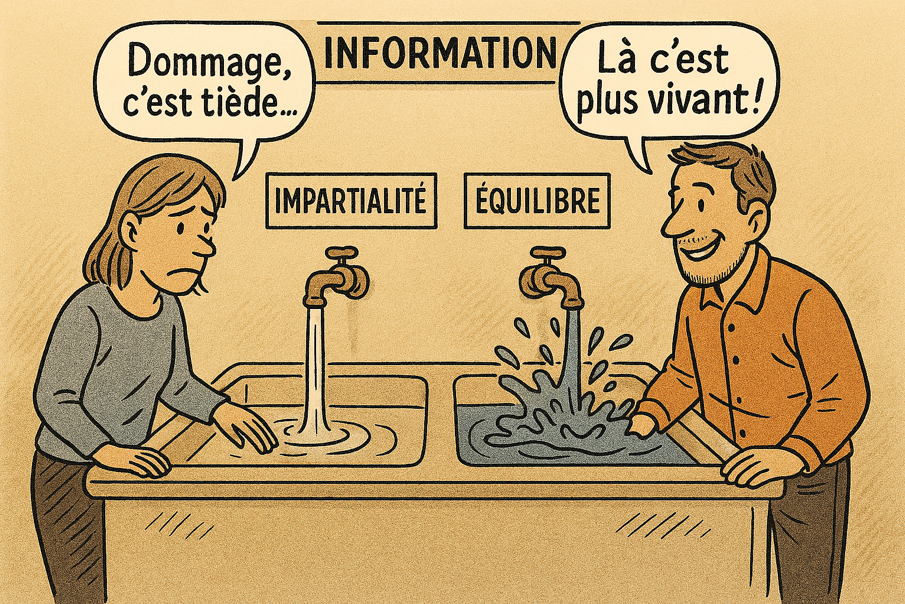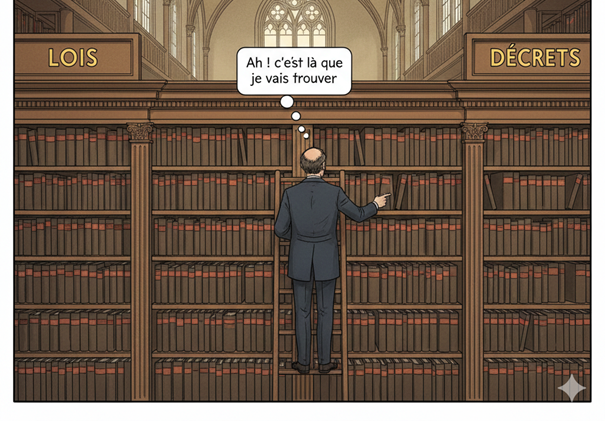L’Arcom « garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ». La phrase est peu connue. Elle figure à l’article de la loi de 1986 qui décrit les missions de l’Arcom (article 3-1), plutôt que dans le Titre III, qui traite du « Secteur public de la communication audiovisuelle ». L’article 43-11 se limite à y indiquer – dans des termes à peu près identiques à ceux qui valent pour les éditeurs privés – que France Télévisions, Radio France ou France Médias Monde doivent « assurer l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ».
Vérification faite sur le site Légifrance, aucune des 13 modifications identifiées de l’article 3-1 ne concerne le membre de phrase cité précédemment, et ce devoir d’impartialité – formulé en creux puisque mis à la charge du régulateur – semble donc appartenir au texte original de la Loi Léotard. Comme le notait Martin Ajdari lors de son audition devant la commission Culture du Sénat, le 1er octobre, Il n’a pas été, pour autant, au cœur des réflexions de l’Arcom, ou du CSA qui l’a précédé. Le thème « n’a pas été abordé en tant que tel à ce jour », indiquait le président de l’Autorité, annonçant en conséquence des travaux destinés à « objectiver cette notion d’impartialité, à lui donner un caractère plus concret ».
La tâche pourrait s’avérer ardue. Rebondissant sur l’arrêt RSF contre Arcom du 13 février 2024, l’Autorité a publié le 17 juillet 2024 une délibération permettant de mettre en musique les exigences du Conseil d’Etat visant à aller au-delà du seul suivi des temps de parole des responsables politiques et de leur soutien, pour mieux mesurer – et donc faire mieux respecter – le pluralisme dans les médias audiovisuels. Dans une nouvelle décision, du 4 juillet 2025, la haute juridiction administrative a continué à préciser la doctrine, indiquant que « l’Arcom, lorsqu’elle est saisie, doit vérifier – sur une période qui, sauf circonstances particulières, doit être suffisamment longue – qu’il n’existe aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la programmation d’une chaîne [en portant] une appréciation globale sur la diversité des expressions, [mais] sans qualifier ou classer les participants aux programmes selon des courants de pensée et d’opinion ».
Si le « fichage » des intervenants, que la lecture de la seule décision de février 2024 pouvait laisser craindre, est donc écarté, cette dernière aboutit bien à durcir les conditions d’appréciation du pluralisme, au sein des émissions d’information et potentiellement au-delà, dans le reste de la programmation. Et cette rigueur accrue s’appliquera à l’audiovisuel public comme aux éditeurs privés. Sites Web, réseaux sociaux ou plateformes de partage de vidéo restent quant à eux exempts de tout encadrement, ajoutant une nuance de risque démocratique à la palette des asymétries législatives et règlementaires dont pâtissent les médias d’information et de création.
Mais, revenant à France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, comment compléter ce dispositif resserré pour donner un « caractère plus concret » à la notion d’impartialité, selon la direction tracée par Martin Ajdari ?
De la même façon que le Conseil d’Etat a exclu une conception millimétrique de la notion de pluralisme, plateau par plateau et à chaque heure du jour et de la nuit, conclure que l’impartialité globale du service public doit être l’impartialité de chacun de ses intervenants conduirait à transformer ses antennes en robinets d’eau tiède, amènerait à bannir les éditorialistes, et ne permettrait guère de proposer davantage que le journal des bonnes nouvelles…
C’est en revanche sur le terrain d’une rigueur irréprochable dans la présentation de l’information, d’une parfaite transparence vis-à-vis du public sur le travail des rédactions, et d’une capacité d’auto-remise en cause en temps réel que se trouvent, sans doute les pistes à creuser :
- Etendre à l’ensemble des émissions qui concourent à l’information (magazines, documentaires…) le service, déjà existant pour les JT, qui permet aux téléspectateurs de consulter les sources utilisées par les journalistes,
- Rendre publique comme France Télévisions s’y est engagée la liste – documentée – des invités appelés à intervenir sur ses antennes,
- (ré)introduire sur les plateaux des débats – politiques mais potentiellement au-delà – des fact-checkers susceptibles de rectifier en temps quasi réel les propos potentiellement infondés d’un intervenant, comme cela avait été le cas au début des années 2010 (Des paroles et des actes…),
- Faciliter au téléspectateur la possibilité de communiquer vers la rédaction (par un dispositif d’interactivité simple de type QR Code ?) afin de faire un commentaire, demander un éclaircissement, ou indiquer ce qu’il pense être une erreur factuelle…
Les possibilités sont nombreuses, pour finir, afin de faire rimer impartialité et exemplarité.
D’après Raymond Aron, « objectivité ne signifie pas impartialité mais universalité ». On est en tenté de suggérer aussi qu’impartialité est équilibre et équité, plutôt que totale neutralité.