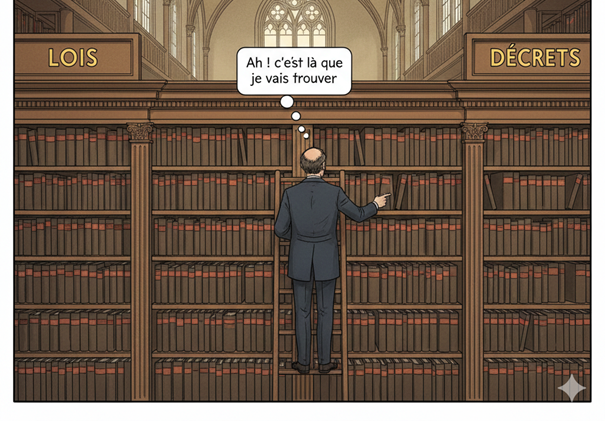L’ardeur d’une conversation produit parfois des mots qui vont au-delà même de ses propres convictions, mais qu’on ne peut plus effacer dès lors qu’ils ont été prononcés.
Le pardon – qu’on demande et qu’on ne s’octroie pas – s’impose quand les paroles ont pu être vraiment blessantes ; la touche rewind suffit parfois, pour dire qu’on a eu tort, quand il s’agit d’un échange de points de vue conduit dans des formes « civilisées ».
Le consensus de départ allait d’évidence, sur la souffrance de la société, la difficulté de l’économie, et la particularité d’une activité que les décideurs publics ont du mal à considérer comme un secteur économique et pas seulement un amusement de soft power.
Franck Riester comme ministre, et Aurore Bergé comme rapporteure, ont failli conduire en 2019/2020 une réflexion législative de fond. La crise sanitaire a mis fin à l’entreprise. Et avant ? Morne plaine ou à peu près, depuis la réforme Sarkozy / Albanel de 2008. Et depuis ? Une proposition de loi vaillamment portée par le sénateur Lafon mais qui peine à cheminer malgré son objet volontairement circonscrit, avec l’appui de Rachida Dati, et l’espoir d’un projet de loi « Post EGI » dont on me dit qu’il devrait être examiné par le Conseil des ministres – et commencer alors son chemin de croix législatif – avant la fin novembre. Je ne m’attarderai pas sur la liste des innovations (smartphone, tablette, fibre optique, 4G, 5G, Wifi, HD, 4K, Replay, SVoD, AVoD, BVoD…) qui auraient peut-être justifié qu’on se préoccupe de leurs conséquences sur la vie du citoyen comme sur le travail des professionnels. On a préféré laisser le chevalier du guet poursuivre chaque nuit sa tournée « dormez-tranquille bonne gens ».
L’échange que j’évoquais partait donc d’une nécessité communément ressentie, de faire toucher du doigt aux élus et autres décideurs qu’il y a toute une filière industrielle en amont du programme qu’ils finissent par déguster. Et, qu’au-delà de la difficulté conjoncturelle, que cette filière est en danger. C’est tout le mérite des fondateurs de LaFA d’avoir structuré la démarche et de l’avoir, notamment, incarnée au travers du Livre Blanc qui constitue une outil documentaire puissant en plus de porteur d’une vision partagée.
La divergence est venue sur l’automobile. Quand j’ai émis la crainte que certains décideurs, qui ont définitivement rangé l’audiovisuel parmi les activités « sympathiques mais pas économiquement signifiantes » ferment leurs écoutilles à tout parallèle reliant les deux univers.
Et j’ai eu tort.
La filière automobile est facile à appréhender. Elle est structurée autour d’un nombre limité d’acteurs dont on connait le poids économique, les emplois – directs et indirects – qu’ils génèrent, la fâcheuse tendance à essayer de passer sous les radars antidélocalisation…
La réalité de l’audiovisuel en particulier, et de la culture en général, est plus complexe, faite d’une myriade de métiers et de savoir-faire, d’une multitude de structures, souvent de tailles modestes, dans lesquelles l’emploi ne s’organise pas forcément au rythme du lundi/vendredi & 9 heures / 18 heures, de montages économiques qui s’apparentent souvent davantage à la jonglerie qu’à la présentation de slides PowerPoint devant le board d’un fonds d’investissement.
Et quand la R&D s’organise dans l’industrie au sein de centres de recherche bénéficiant d’un soutien massif sous la forme du CIR, la R&D culturelle prend pour l’essentiel la forme de feuilles roulées en boule. Il faut être arrivé au D de Développement pour qu’un cadre économique commence à se mettre en place.
J’ai eu tort aussi parce que films, séries, dessins animés ou documentaires, sont aussi des ambassadeurs. Au sens propre dans les festivals, les cessions de droits et, parfois, les adaptations. Mais ambassadeurs aussi à travers ce qu’ils montrent, personnages, monuments, paysages… Je n’aurais sans doute jamais connu Kerguen sans Les petites victoires, comme je n’aurai rien su de Sainte Marie la Mauderne sans La grande séduction. Plus que le côté afternoon tea du soft power il faudrait pouvoir valoriser ces retombées indirectes, de la vente des livres dont les fims sont adaptés jusqu’au tourisme qu’ils génèrent.
Je pourrais prolonger encore longtemps en parlant des territoires, que les productions font vivre là où la présence du secteur automobile se limite à une station-service. En libre-service de plus en plus souvent. Mais j’arrête là mon mea culpa !
Dans quelques années – et déjà en taxi dans quelques capitales internationales – la question de l’alternative automobile ou production ne se posera plus. Les voitures se conduiront toute seules. Le conducteur pourra oublier son clignotant, son rétroviseur, des pédales… et utiliser le temps regagné à rêver, à lire ou visionner un programme. La boucle est bouclée !
Et merci à celle qui se reconnaitra, j’espère, de m’avoir poussé à mettre noir sur blanc ces idées.