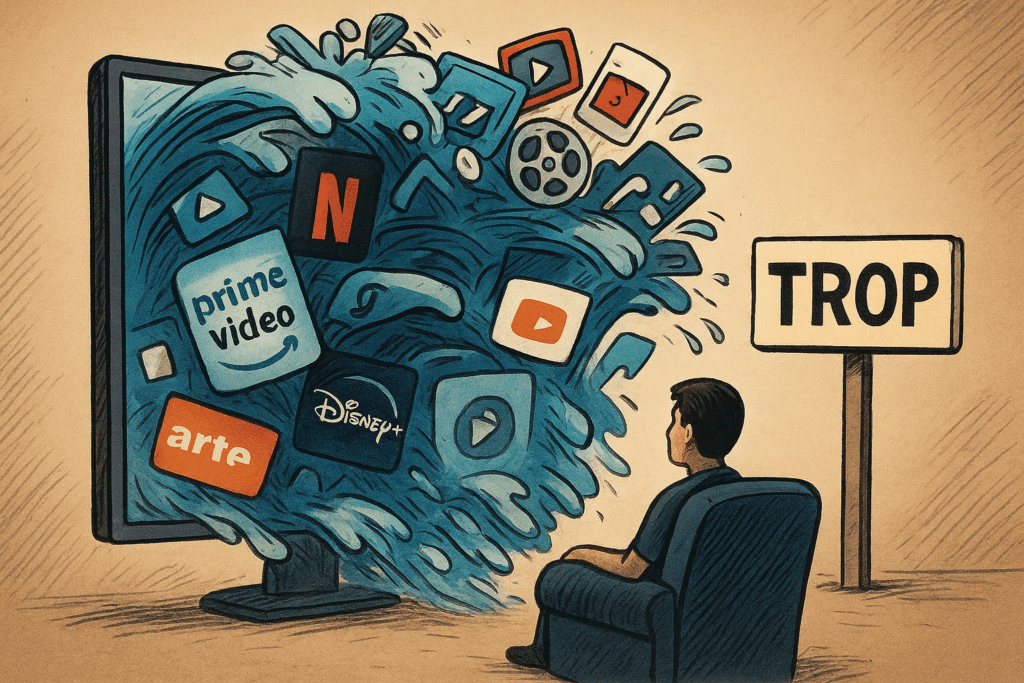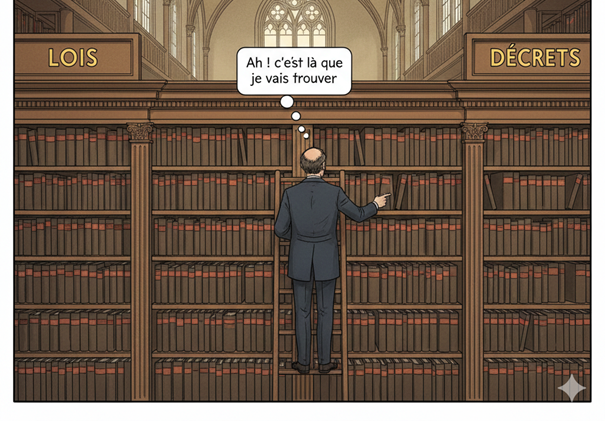À la fin du mois de juillet, le Baromètre SVoD de Médiamétrie décomptait plus de 150 000 heures de programmes dans les catalogues des quinze plateformes qu’il analyse, dont, par exemple, près de 15 000 films (sortis en salle ou DTV) et plus de 100 000 épisodes de séries…
Au même moment, les plateformes de BVoD des principaux groupes audiovisuels, arte.tv, france.tv, M6+, RMC BFM Play et TF1+ totalisaient au bas mot 100 000 heures de séries, films et émissions.
Et ceux que ces 250 000 heures ne permettaient pas de contenter pouvaient se tourner vers les 353 chaînes FAST disponibles en français sur l’une des neuf plateformes étudiées par NPA Conseil… sans compter avec les plateformes de partage de vidéos et avec les réseaux sociaux.
« Environ 720 000 heures de vidéos sont publiées chaque jour sur YouTube », indique le moteur d’IA de Google, Gemini et, bien que dans des proportions sans comparaison, c’est au-delà chacune de ces composantes de l’offre audiovisuelle dont le volume continue à augmenter. Rien qu’au 2e trimestre, le nombre de chaînes FAST disponibles dans le monde a par exemple augmenté de 14 %, d’après Nielsen.
Se projeter vingt ans en arrière donne la mesure de ce changement d’échelle. A la veille du lancement de la TNT, le paysage audiovisuel se limitait pour trois quarts des Français au 5 canaux gratuits (TF1, France 2, France 3, M6 et la fréquence que se partageaient Arte et La Cinquième), soit un peu plus de 40 000 heures… pour l’année entière, sans que le replay ait encore été inventé (M6 replay a été lancé au printemps 2008), et alors que Netflix n’avait pas encore inventé la SVoD (décembre 2007) …
Pendant près de deux décennies – jusqu’au Covid grossièrement – l’allongement régulier de la durée d’écoute a répondu à l’élargissement constant de l’offre disponible ; la tendance s’est retournée depuis, en France comme dans les marchés comparables. Et la consommation vidéo dans son ensemble – et pas seulement la télévision linéaire – tend à s’éroder ou, au mieux, reste stable.
Ce déséquilibre dans les évolutions de l’offre et de la demande s’ajoute aux facteurs exogènes de tension sur les différentes sources de financement (recherche d’économies budgétaire et ressource publique, croissance faible de l’économie et publicité, arbitrages des ménages, poids du piratage et abonnements… ; lire sur la plateforme Insight NPA Streaming et CTV : la tentation du all-in pour 2025/2026).
La logique voudrait, au-delà, que le rééquilibrage se fasse par la réduction des volumes de nouvelles productions et/ou par un mouvement de consolidation des éditeurs.
S’agissant des programmes préfinancés par des chaînes ou des plateformes, les signes d’inflexion se multiplient. Le nombre d’heures de fiction produites à l’échelle européenne a par exemple diminué de 6 % en 2023, d’après les données de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, et les commandes des principaux streamers (Apple TV+, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ et Prime Video) ont diminué au premier semestre de 24 % au niveau mondial, d’après Ampere Analysis ; au Royaume-Uni, la baisse a été de 5 % entre 2022 et 2024, concernant le volume de production des groupes historiques, d’après l’Ofcom.
En France, les décrets production ne permettent pas aux éditeurs – chaînes comme plateformes de SVoD – de réguler leurs dépenses, celles-ci étant fixées en pourcentage du chiffre d’affaires. S’y ajoute pour les chaînes une obligation de commandes de nouveaux programmes à destination du prime time (cent vingt heures par an en début de soirée).
Les alliances qui se sont esquissées ces derniers mois, qu’il s’agisse de l’agrégation autour des broadcasters leaders (Arte, Le Figaro TV et L’Equipe autour de TF1, Arte, les chaînes parlementaires, France 24, l’INA et TV 5 Monde autour de France.tv, Pluto TV avec M6+) ou des alliances plus récentes entre France.tv et Amazon d’une part, entre TF1 et Netflix, de l’autre, ouvrent la voie à une plus grande rationalité dans l’organisation de l’offre : coup d’arrêt au « toujours plus » de volume, et meilleure satisfaction du public grâce à une vision plus globale de l’offre disponible et un meilleur accompagnement dans le choix du programme à visionner.
Mais parce qu’ils n’offrent pas de marges de manœuvre aux éditeurs, les décrets en vigueur ne permettent pas de rentrer aujourd’hui dans cette logique d’offre plus raisonnée. Sachant qu’une évolution du cadre devrait être précédée d’une importante étude d’impact, afin qu’une évolution des règles n’entraine pas d’affaiblissement de l’écosystème de la production. Un sujet de réflexion supplémentaire à proposer à ce gouvernement. Ou au suivant.