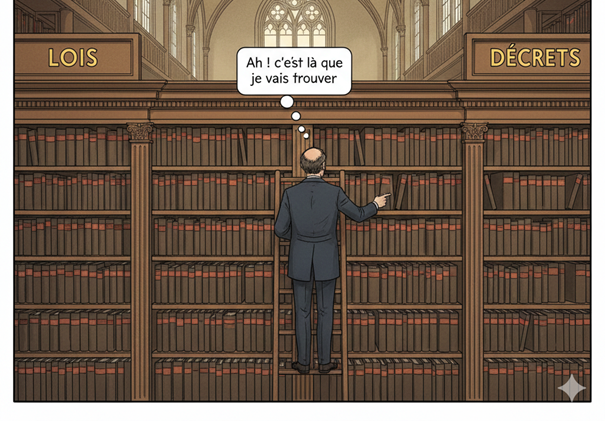Rachida Dati ne renonce pas. Le 18 mai, elle indiquait dans La Tribune Dimanche que sa « réforme de l’audiovisuel public, qui est attendue depuis plus de dix ans […] est toujours à l’ordre du jour » et que le texte pourrait être débattu à l’Assemblée nationale au cours de la semaine du 23 juin ; le 20 mai, elle affirmait par ailleurs lors de son audition par la Commission des Finances de l’Assemblée que « le gouvernement donnera une traduction législative aux Etats Généraux de l’Information avant la fin de l’année » et que le projet de loi préparé dans ce sens est en cours de « finalisation ». Les sujets à traiter sont suffisamment nombreux pour que cette ardeur réformatrice trouve sans peine à s’employer.
D’autant que le document que le Conseil Européen des ministres de la Culture a approuvé le 13 mai rappelle à point nommé que les lignes sont appelées à bouger dans les 18 prochains mois, bien au-delà de la seule gouvernance de l’audiovisuel public, puisque l’échéance pour la révision de la directive SMA est fixée au 19 décembre 2026. Ce document vise à « ouvrir une discussion factuelle » sur certains aspects de la directive SMA, sans « préjuger d’éventuelles négociations futures » ni prétendre à établir « une liste exhaustive », ainsi que le relève Marc le Roy, dans l’analyse qu’il en propose ce 22 mai dans l’Insight NPA.
Signe que « ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement », les 19 pages (annexes comprises) que totalisent ces « conclusions du Conseil relatives à l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de médias audiovisuels et aux services de plateformes de partage de vidéos » suffisent pour soulever des enjeux essentiels, sur le fond de la politique européenne et sur la cohérence dans sa mise en œuvre.
Rappelant notamment, dans la lignée du Règlement sur la Liberté des Médias (EMFA), la contribution essentielle des médias traditionnels à la production d’une information fiable, le Conseil ouvre une triple perspective.
Sur la façon d’abord de rendre plus efficace les dispositifs destinés à garantir la visibilité des Services d’intérêt général (SIG), compte tenu de leur participation à la lutte contre la désinformation. « Les dispositions actuelles de la directive SMA ont perdu en clarté quant à la question de savoir dans quelle mesure les États membres peuvent adopter des dispositions relatives à la visibilité concernant les entreprises établies dans d’autres États membres », relève le Conseil, se référant peut-être aux difficultés rencontrées par l’Italie et par la France (l’Arcom) de la part de la Commission, pour la mise en œuvre des dispositifs qu’ils avaient conçus. Et soulevant implicitement, par là même, la question du champ d’application du principe du pays d’origine dont la Commission fait un usage extensif, sur ce point comme sur d’autres.
Sur la simplification possible du soutien financier apporté aux SIG (l’audiovisuel public au moins) ensuite, en « invitant la Commission à une réflexion sur la simplification de la procédure du versement d’aides d’Etat aux SIG qui pourrait aboutir à une mesure d’exception globale de la déclaration préalable à la Commission », note Marc le Roy.
Sur l’organisation du marché publicitaire encore, « alors que l’importance croissante des plateformes en ligne et des services de plateformes de partage de vidéos (…) a entraîné une diminution des recettes publicitaires pour les médias traditionnels, et en particulier pour les services de médias audiovisuels, note le Conseil. Des conditions de concurrence équitables pourraient contribuer à faire en sorte que les fournisseurs de services de médias monétisent suffisamment leurs contenus dans le contexte de la transition numérique ». Un chantier sur la résorption des asymétries réglementaires devrait donc être ouvert dans le cadre de la révision de la directive.
La réflexion que le Conseil semble enfin appeler de ses vœux, sur la façon de ne pas sacrifier des impératifs tels que la défense du pluralisme au seul jeu du marché intérieur, apparaît d’autant plus opportune que la première est indissociable de dispositions économiques permettant d’assurer la pérennité des médias.
Et permettant finalement de conduire dans cet état d’esprit la mise en cohérence entre la directive SMA et les règlements publiés ces dernières années (DMA, DSA, EMFA en particulier).